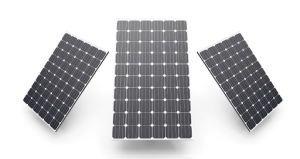La Guinée Conakry amorce une nouvelle page de son développement industriel et minier. Avec le projet Simandou, elle ambitionne de faire du fer le pilier d’une transformation économique majeure, à l’image des pays du Golfe ayant bâti leur richesse sur l’or noir. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, en fait un symbole de la souveraineté et de l’émergence guinéennes, soulignant déjà les avancées enregistrées sur le terrain. Mais derrière les réalisations impressionnantes — des millions de tonnes de minerai extraites en phase préparatoire, des centaines de kilomètres d’infrastructures déjà posés et des milliers d’emplois créés — subsistent des inquiétudes grandissantes. Aux risques environnementaux s’ajoutent désormais des interrogations sur la santé et la sécurité au travail, alors que le pays espère tirer de Simandou un dividende économique historique.
Simandou émerge dans un paysage encore marqué par les séquelles laissées par deux décennies d’exploitation de la bauxite. Dans les régions de Boké, Kindia ou Télimélé, l’extraction à ciel ouvert a appauvri les sols, dégradé les massifs forestiers, accru les poussières en suspension et contaminé plusieurs rivières. Ces conséquences durables alimentent aujourd’hui la prudence des experts et la défiance des communautés, qui redoutent de voir se répéter un cycle de promesses non tenues et de dommages irréversibles.
Malgré cet héritage, le chantier avance à un rythme inédit. Les opérateurs annoncent avoir déjà extrait plus de six millions de tonnes de minerai en phase préparatoire, destinées aux tests logistiques et au calibrage industriel. Sur le corridor ferroviaire, près de 270 kilomètres de voie ont été posés sur les 650 prévus, reliant progressivement les zones de montagne aux plaines littorales. Le port minéralier de Morebayah affiche environ 35 % de réalisation, avec l’achèvement des jetées principales et la mise en place des fondations des terminaux d’exportation. Ces avancées témoignent de la détermination des partenaires du projet à respecter le calendrier, mais elles accentuent également les pressions sur les milieux naturels, déjà fragilisés par les terrassements et les détournements de cours d’eau.
Entre engagements visibles et critiques persistantes
Les études d’impact environnemental et social menées par Rio Tinto Simfer et Wildlife Conservation Society (WCS) constituent l’un des volets les plus documentés du projet. Elles mettent en évidence la nécessité de préserver les corridors écologiques, de mieux contrôler les perturbations hydrologiques et de surveiller les impacts sur les terres agricoles. Les opérateurs insistent sur le respect des standards internationaux de la Banque mondiale et de l’IFC, tout en affirmant que la gouvernance communautaire est au cœur de leurs dispositifs.
Sur le plan économique, l’État guinéen mise beaucoup sur Simandou. Les projections gouvernementales évoquent la création de près de vingt mille emplois directs et indirects durant la phase de construction, et plusieurs milliers supplémentaires une fois l’exploitation stabilisée. Le ministère de l’Économie estime que le projet pourrait ajouter entre un et un virgule cinq points à la croissance annuelle du PIB, faisant de Simandou l’un des moteurs majeurs de l’économie nationale. Les recettes publiques attendues oscillent entre trois cent cinquante et cinq cents millions de dollars par an selon le rythme d’exportation, une perspective qui alimente les attentes en matière de développement des infrastructures et de services publics.
Mais malgré ces engagements et ces perspectives, des inquiétudes persistent. Plusieurs organisations de la société civile signalent une augmentation des incidents mineurs sur les chantiers, en particulier dans les zones de coactivité entre engins lourds et personnels. Les syndicats évoquent des tensions liées au rythme accéléré des travaux, aux longues périodes de travail et à l’insuffisance de la formation pratique pour certains sous-traitants. Ils craignent que la pression économique et politique autour du projet n’entraîne un relâchement de la vigilance en matière de santé et sécurité au travail. Les experts rappellent que des projets similaires en Afrique ont souvent été confrontés à une hausse des accidents lors de la phase d’intensification des travaux, faute de mécanismes solides d’audit et de supervision.
Un avenir à construire : responsabilité écologique, sécurité des travailleurs et retombées durables
À mesure que Simandou progresse, les recommandations des spécialistes convergent vers une même nécessité : renforcer la transparence et le contrôle des impacts. Les autorités sont invitées à consolider les inspections environnementales, à garantir la publication régulière des données liées à la qualité des eaux, des sols et de l’air, et à renforcer les mécanismes de compensation pour les communautés touchées. Dans le domaine de la sécurité au travail, les experts appellent à une supervision accrue des sous-traitants, à une formation renforcée des travailleurs et à la mise en œuvre d’un système d’alerte robuste pour prévenir les accidents dans les zones à haut risque.
La réussite de Simandou dépendra aussi de sa capacité à générer des retombées réellement durables. Les attentes sont fortes : développement d’infrastructures nationales grâce au corridor ferroviaire, montée en compétence de la main-d’œuvre locale, attractivité accrue pour les investissements étrangers et diversification des recettes publiques. Mais ces promesses devront se matérialiser sans sacrifier l’environnement ni compromettre la sécurité des milliers de travailleurs mobilisés.
Au final, Simandou cristallise les espoirs et les contradictions d’un pays qui aspire à la transformation économique tout en cherchant à éviter les erreurs du passé. Si les engagements environnementaux et sociaux annoncés se traduisent par une mise en œuvre rigoureuse et transparente, la Guinée pourrait réussir le pari de la « mine du futur ». Dans le cas contraire, ce projet historique risque de s’ajouter à la longue liste des richesses africaines extraites sans retombées durables pour les populations.
© LÉONEL AKOSSO