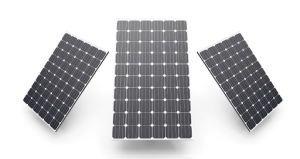Un rapport de l’Environmental Justice Foundation (EJF) met en lumière le lien direct entre la surpêche au Sénégal et la hausse dramatique des migrations vers l’Europe. Alors que les flottes industrielles pillent les eaux sénégalaises, les pêcheurs artisanaux n’ont d’autre choix que de fuir une mer vidée de ses ressources. En 2024, près de 64 000 personnes ont tenté la traversée, souvent au péril de leur vie.
Au Sénégal, 3 % de la population active dépend de la pêche, pilier vital de l’économie et de la sécurité alimentaire du pays. Mais ce secteur est en crise. En cause : la surpêche et la pêche illégale, notamment par des flottes industrielles étrangères, opérant souvent sous couvert d’accords opaques. Résultat : un appauvrissement dramatique des stocks halieutiques. L’EJF alerte sur l’effondrement du poisson dans les eaux sénégalaises, dont une part croissante est exportée vers l’Union européenne et la Chine, au détriment des communautés locales.
Face à l’appauvrissement des ressources marines, de nombreux pêcheurs n’ont plus de quoi nourrir leurs familles. La migration devient alors une option de survie. En 2024, 63 970 personnes ont franchi illégalement les frontières espagnoles, soit plus du double de 2022. Les départs via les îles Canaries ont explosé (+200 % en deux ans), faisant de cette route-là plus meurtrière au monde. « Le gouvernement a pris la décision de vendre la mer et nous avons pris la décision de partir par la mer », résume avec amertume Abdou Rakhmane Sow, un ancien pêcheur devenu migrant.
Des récits poignants, symboles d’un naufrage collectif
Dans son documentaire, l’EJF retrace les trajectoires de pêcheurs sénégalais comme Abdoulaye Sady, qui raconte : « Le neuvième jour, on n’avait plus d’eau, plus de carburant, des gens tombaient malades. Certains sont morts. Ils avaient le même rêve que moi, mais ne sont jamais arrivés. » Derrière ces drames, ce sont des familles entières qui sombrent : celles de Modou Boye Seck, qui dit avoir perdu « près de dix membres de sa famille » dans un naufrage. Pendant que les flottes étrangères continuent de piller, ces tragédies deviennent le quotidien de nombreux villages côtiers.
Le rapport de l’EJF appelle les gouvernements sénégalais et européens à mettre fin à cette spirale. Parmi les recommandations : interdire les techniques destructrices comme le chalutage de fond, renforcer la transparence des accords de pêche et soutenir les pêcheries artisanales. Pour Steve Trent, président de l’EJF, « les autorités européennes doivent rendre les pêcheries sénégalaises à leur peuple ». Sans cela, l’exode se poursuivra, alimenté non pas par le rêve européen, mais par l’effondrement silencieux d’un écosystème et d’un mode de vie millénaire.
Boris Ngounou